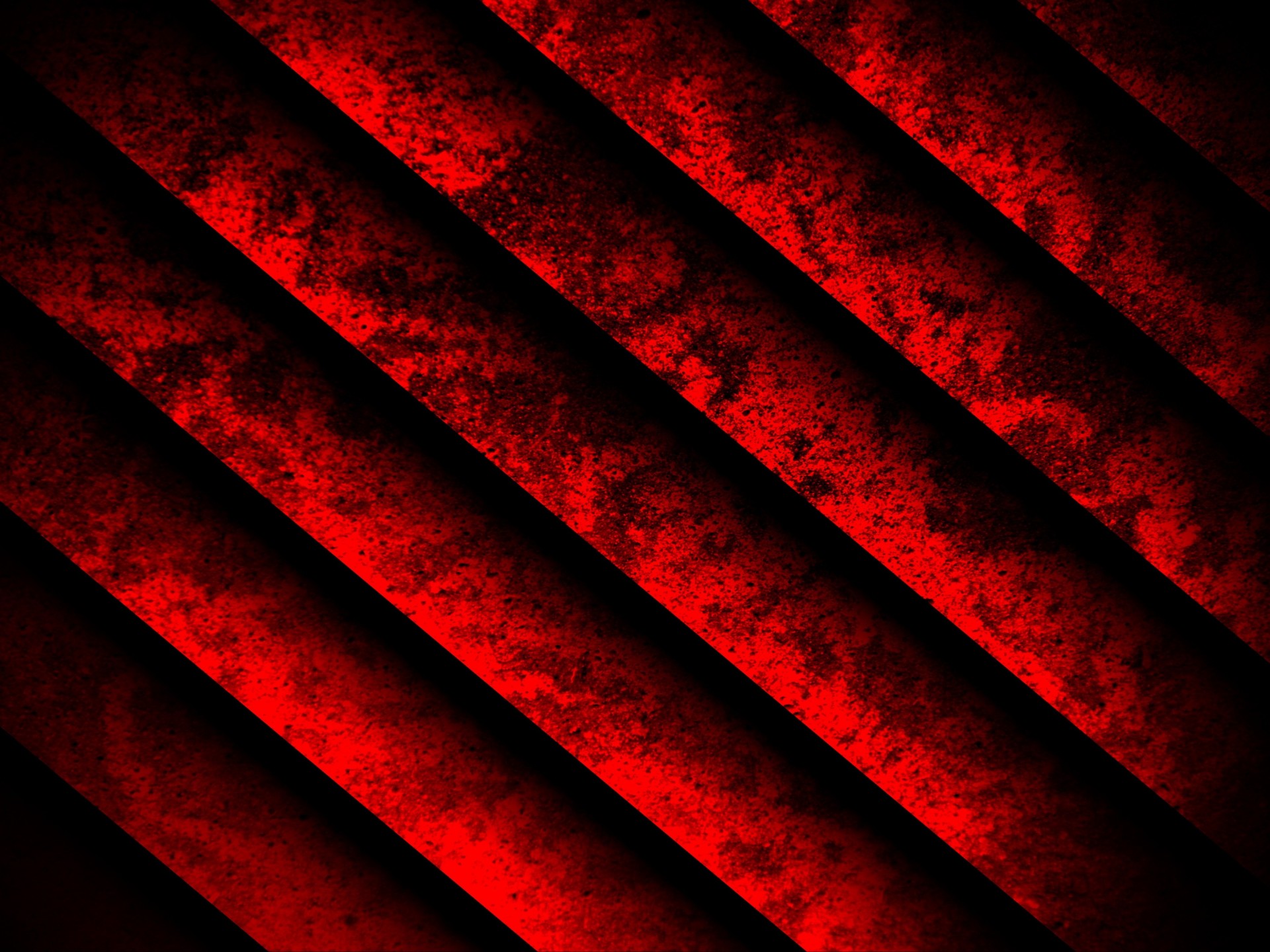
30 août 2025
LIGNES ROUGES par Gwen Breës
« Ligne rouge ». Symbole d’un interdit, d’un ultimatum lancé au présent. Manière de dire stop, ça suffit, les bornes sont dépassées. « Tracer une ligne rouge pour Gaza ». Expression utilisée aux Pays-Bas, le 19 mai, après 17 mois de « guerre ». Leitmotiv d’une manifestation rassemblant plus de 100.000 personnes pour demander à leur gouvernement de conditionner les relations avec Israël au respect du droit international. Les images de cette marée humaine vêtue de rouge furent à ce point frappantes, et le message efficace, que le concept fut repris dans plusieurs pays lors de grandes manifestations ou d’actions symboliques.
Il y a tout de même intérêt à manier cette image avec précaution. Car si fixer un seuil revient à ne voir le problème qu’au moment où il est franchi, que fait-on des gouttes qui remplissent le vase avant qu’il ne déborde ?
En politique, une « ligne rouge » est souvent fluctuante. Dans le cas d’Israël, elle est même particulièrement élastique. On se souvient que Joe Biden estima, après six mois de soutien inébranlable aux massacres israéliens, que l’envahissement de Rafah était une « ligne rouge »… qu’il laissa être allègrement franchie le mois suivant. Rafah est aujourd’hui entièrement rayée de la carte.
Donald Trump, se rêvant en faiseur de paix, imposa un cessez-le-feu dès le jour de son accession au pouvoir… avant de laisser Israël le rompre pour intensifier sa campagne d’anéantissement et de famine à Gaza — et de renvoyer les otages israéliens à leur sort. Depuis lors, Trump a permis à Israël pousser le bouchon de plus en plus loin, donnant sa bénédiction à tous les actes commis contre la population palestinienne.
Quant à la Commission européenne, sa présidente a décrit la situation à Gaza d’« abjecte et insupportable » et qu’elle devait « cesser immédiatement ». C’était en juillet, après 22 mois d’offensive. Trois mois plus tôt, la cheffe de la diplomatie européenne déclarait déjà qu’Israël avait « franchi la ligne »… Aucune de ces condamnations n’a dépassé le stade de la gesticulation. Invoquer une « ligne rouge » nécessite donc de préciser sans ambiguïté où elle se situe, car elle symbolise la limite entre ce qui est moralement et humainement acceptable et ce qui ne l’est pas.
Dans le cas de la Palestine, se jauge-t-elle au nombre de morts ? De jours ? Ou bien en actes ?
 Est-elle piétinée depuis que Gaza City est privée des quelques heures de « pause humanitaire » censées permettre de se nourrir et de se soigner ? Ou bien depuis que l’ONU a été écartée au profit d’une organisation coloniale de « l’aide humanitaire » ? Peut-être quand les camions furent à nouveau autorisés à entrer pour calmer l’opprobre internationale, tout en butant sur un mur de tracasseries administratives. À moins que cela ne remonte déjà à l’interdiction du lait prénatal. Ou au blocage des olives et des dattes, pour cause de noyaux pouvant être plantés. Ou encore, lorsque le Nutella et les friandises passèrent la frontière alors que les œufs frais et les protéines restaient immobilisés à quelques kilomètres des personnes affamées.
Est-elle piétinée depuis que Gaza City est privée des quelques heures de « pause humanitaire » censées permettre de se nourrir et de se soigner ? Ou bien depuis que l’ONU a été écartée au profit d’une organisation coloniale de « l’aide humanitaire » ? Peut-être quand les camions furent à nouveau autorisés à entrer pour calmer l’opprobre internationale, tout en butant sur un mur de tracasseries administratives. À moins que cela ne remonte déjà à l’interdiction du lait prénatal. Ou au blocage des olives et des dattes, pour cause de noyaux pouvant être plantés. Ou encore, lorsque le Nutella et les friandises passèrent la frontière alors que les œufs frais et les protéines restaient immobilisés à quelques kilomètres des personnes affamées.
A-t-elle été outrepassée plus tôt : à l’époque où les drones ont commencé à viser des passants, les quadricoptères à entrer dans des chambres pendant la nuit, ou les robots télécommandés à pénétrer des quartiers pour faire tout exploser dans un rayon de 100 mètres…?
Il est possible que la barrière de l’intolérable ait volé en éclats dès les bombes s’abattirent sur des zones densément peuplées sans évacuation préalable. Dès l’utilisation de munitions au phosphore blanc. Ou encore quand l’eau, l’électricité, l’internet, le carburant et la livraison de vivres ont été coupés.
Sans doute avait-elle déjà cédé dès les premiers appels au meurtre proférés par les dirigeants, qui brisèrent les dernières digues contre la déshumanisation raciste et offrirent l’impunité aux crimes des soldats et des colons.
À quoi reconnaît-on la limite entre une guerre et une campagne d’extermination ? Aux ordres d’évacuation impossibles, qui forcent un million d’individus à quitter leurs maisons — pour être envoyés dans des « zones sûres » aussitôt bombardées. Aux doubles frappes, qui ne laissent aucune chance aux rescapés ni aux secouristes. À l’intelligence artificielle, qui calcule qu’un militant de bas rang « vaut » la mort de 20 civils, et un commandant une centaine. Ou simplement au moment où l’on voit des catégories entières systématiquement visées — enfants, femmes, médecins, enseignants, humanitaires, journalistes.
Combien d’horreurs ont été tièdement condamnées, avant que le silence recouvre leurs multiples répétitions ? Combien d’écoles, d’hôpitaux, de camps de réfugiés ont été bombardés sans qu’aucun gouvernement ne bronche ? Certes, condamner les « excès » israéliens semble exiger un emploi à temps plein. Mais avant que nos États ne cessent de répéter le « droit à se défendre », combien d’adultes ont été fusillés sur les chemins de « l’aide humanitaire », combien d’enfants pulvérisés en allant chercher de l’eau ? Combien de maisons, d’universités, de champs, d’arbres, de cimetières, de trottoirs ont été réduits en poussière ?
Dans les pays occidentaux, combien de manifestants arrêtés, de mouvements sociaux réprimés, pour avoir dénoncé un génocide face à des gouvernements qui s’y refusaient ?
Conforté par le « droit de légitime vengeance » tacitement reconnu par de nombreux États, le régime israélien s’est mis à agir sans limite. Il a couvert ses actes par le martèlement d’une réalité parallèle à laquelle nos propres dirigeants nous ont sommés de croire — y ont-ils cru eux-mêmes ? Il nous a fallu endurer un cynisme insondable — par exemple, entendre qu’il revient au peuple colonisé d’assurer la sécurité de la puissance colonisatrice, sous peine de voir nié son droit même à exister sur sa propre terre. Il a fallu traverser un torrent ininterrompu de déni et de mensonges pour parvenir seulement à nommer des évidences : la destruction d’un territoire et du peuple qui y vit. Et déjouer une infinité de stratégies de culpabilisation et de délégitimation, destinées à paralyser toute critique.
Et ce n’est pas fini. La « communauté internationale » continue de saper ses propres fondements juridiques en s’abstenant d’imposer des garde-fous aux pulsions exterminatrices d’Israël.
À commencer par la ligne verte de 1967, censée marquer la frontière des territoires palestiniens : violée depuis des décennies, elle est désormais gommée par un État qui revendique ouvertement son abolition. Et intensifie le harcèlement et l’expulsion des Palestiniens de Cisjordanie — avec des méthodes différentes de celles employées à Gaza, mais un même objectif : inoculer aux populations locales l’idée qu’elles ne sont jamais en sécurité. Nulle part. Jusqu’à ce qu’elles finissent par partir « d’elles-mêmes », bouclant ainsi la boucle entamée en 1948.
Dès les premières heures de son offensive, il y a près de 700 jours, Israël s’est affranchi de toute règle humanitaire et de toute norme morale. La situation actuelle tient du point de non-retour : que peut-on attendre d’un tel régime, sinon la déportation des Palestiniens, l’annexion de leur pays et une expansion territoriale vers le Liban et la Syrie ? Seules des interventions extérieures peuvent changer le cours des choses… Ce qui exigerait dans un premier temps, non des menaces vagues, ni un saupoudrage de sanctions graduées, mais une rupture nette et immédiate de toutes les relations économiques, commerciales, militaires, scientifiques, universitaires et culturelles avec Israël. Dès aujourd’hui. Pour sauver ce qui peut encore l’être — des vies, des poches de Gaza City ou de Deir al-Balah —, empêcher la déportation, mettre fin au cycle des faits accomplis.
Cela semble tragiquement illusoire, tant la tornade israélienne n’affronte qu’une légère brise désapprobatrice. Depuis 700 jours, la « communauté internationale » laisse parler dans le vide ses propres institutions : l’Organisation des Nations-Unies (ONU) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), par exemple, en sont réduites à étaler leur impuissance lorsqu’elles dénoncent les exactions commises à Gaza sans que cela soit suivi de la moindre action contraignante.
 Dans un vertigineux renversement de situation, les « lignes rouges » ont été retournées contre ceux qui tentent de les faire tenir. Israël a quasiment assimilé l’Office des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à une organisation terroriste. Parallèlement, ses services secrets ont déployé un arsenal de pressions, écoutes, intimidations et menaces physiques contre des enquêteurs et juges de la Cour pénale internationale (CPI). Quant au procureur Karim Khan, après avoir obtenu des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Yoav Gallant, et alors qu’il préparait l’inculpation de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, il a soudain fait face à une plainte pour conduite sexuelle inappropriée, qui a provoqué sa mise à l’écart. Une enquête est en cours. Mais une chose est sûre : le Mossad est très actif à La Haye, où est établie la CPI. À tel point qu’en juillet 2025, les Pays-Bas, pourtant soutiens d’Israël, ont inscrit leur allié sur une liste de pays menaçant leur sécurité nationale, aux côtés de l’Iran, de la Russie et de la Turquie.
Dans un vertigineux renversement de situation, les « lignes rouges » ont été retournées contre ceux qui tentent de les faire tenir. Israël a quasiment assimilé l’Office des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à une organisation terroriste. Parallèlement, ses services secrets ont déployé un arsenal de pressions, écoutes, intimidations et menaces physiques contre des enquêteurs et juges de la Cour pénale internationale (CPI). Quant au procureur Karim Khan, après avoir obtenu des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Yoav Gallant, et alors qu’il préparait l’inculpation de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, il a soudain fait face à une plainte pour conduite sexuelle inappropriée, qui a provoqué sa mise à l’écart. Une enquête est en cours. Mais une chose est sûre : le Mossad est très actif à La Haye, où est établie la CPI. À tel point qu’en juillet 2025, les Pays-Bas, pourtant soutiens d’Israël, ont inscrit leur allié sur une liste de pays menaçant leur sécurité nationale, aux côtés de l’Iran, de la Russie et de la Turquie.
Quant aux États-Unis, ils n’agissent pas pour empêcher la commission de crimes contre l’humanité, mais pour neutraliser les instances chargées de les juger ou de les prévenir. Ces derniers mois, des sanctions ont ainsi visé des membres de la CPI ainsi que la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la Palestine. En juillet, l’administration Trump est allée jusqu’à menacer les États signataires du Traité de Rome de représailles diplomatiques et économiques si la CPI poursuivait ses procédures contre Israël — une manière aussi de se protéger eux-mêmes, tant leur implication à Gaza est directe : armes, renseignements, soutien politique. Fin août, Washington a refusé d’accorder des visas aux membres de l’Autorité palestinienne. Un refus qui ne se limite pas à empêcher leur participation à l’Assemblée générale de l’ONU, qui doit proclamer la reconnaissance d’un État palestinien, mais qui manifeste la volonté de saboter toute diplomatie contraire aux intérêts du régime israélien.
Cette croisade pour l’impunité passe par un saccage méthodique des cadres internationaux. Et il n’est pas de bon augure que si peu de gouvernements aient jugé essentiel de soutenir le principe du droit à l’autodétermination des peuples, l’importance de l’ONU et l’indépendance de la CPI.
Inutile de préciser que si les conventions et les traités internationaux devaient être réécrits à la lumière des précédents qu’Israël a été autorisé à imposer, le droit ne tournerait pas à l’avantage des peuples colonisés, des minorités, ni des petits États. Quoiqu’il en soit, les puissances coloniales et impérialistes capables d’imposer « la paix par la force » — pour paraphraser Trump et Netanyahu — foulent ces textes aux pieds, avec d’autant plus de conviction que la démonstration vient d’être faite qu’ils n’engagent pas même ceux qui les ont signés.
 Dans ce paysage sinistré, où la ligne de faille des institutions internationales s’élargit chaque jour, la Palestine est devenue un champ de bataille d’un droit en ruines. Les « lignes rouges » ont été repoussées si loin qu’elles ne sont plus que des incantations vaines. Pour en tracer de nouvelles et refuser la normalisation des pratiques israéliennes de dépossession et de nettoyage ethnique, y a-t-il d’autre issue que de renforcer le multilatéralisme et les institutions internationales, tout en isolant au maximum le couple israélo-américain ?
Dans ce paysage sinistré, où la ligne de faille des institutions internationales s’élargit chaque jour, la Palestine est devenue un champ de bataille d’un droit en ruines. Les « lignes rouges » ont été repoussées si loin qu’elles ne sont plus que des incantations vaines. Pour en tracer de nouvelles et refuser la normalisation des pratiques israéliennes de dépossession et de nettoyage ethnique, y a-t-il d’autre issue que de renforcer le multilatéralisme et les institutions internationales, tout en isolant au maximum le couple israélo-américain ?
Gwen Breës, sur sa page FB et dans l’Asympto, avec l’aimable autorisation de l’auteur



Christine Pagnoulle
Posted at 15:43h, 30 aoûtAutant de constats désolants et impossibles à réfuter.
Autant de raisons de manifester à nouveau ce dimanche 7 septembre